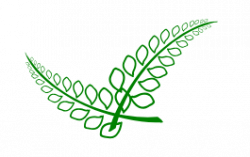Dans le 7ème arrondissement de Paris se cache un trésor naturel et historique méconnu du grand public : le Jardin de Matignon. Ce magnifique espace vert de près de 3 hectares, rattaché à la résidence officielle du Premier ministre français, n'ouvre ses portes qu'en de rares occasions, dévoilant ainsi ses richesses botaniques et son patrimoine exceptionnel aux visiteurs privilégiés.
L'histoire méconnue du Jardin de Matignon
Le Jardin de Matignon représente le plus grand jardin privé de Paris avec ses 2,5 hectares, surpassant même celui de l'Élysée d'un hectare. Cet espace verdoyant est indissociable de l'Hôtel Matignon, devenu résidence officielle du Premier ministre français depuis 1922, mais son histoire remonte bien plus loin dans le temps.
La création du jardin et son évolution architecturale
Le jardin a vu le jour dans les années 1720 sous la direction de deux architectes paysagistes talentueux : Claude Desgots et Charles Alexandre de Calonne. Au fil des siècles, l'aménagement a connu plusieurs transformations majeures. La plus notable fut sa métamorphose en jardin à l'anglaise par Talleyrand entre 1808 et 1811, puis son réaménagement par le paysagiste Achille Duchêne en 1905. Aujourd'hui, le visiteur peut admirer différentes sections harmonieusement agencées : une terrasse élégante, un parterre central soigné, des bosquets ombragés et une orangerie. Parmi les curiosités dissimulées dans ce lieu chargé d'histoire, on trouve une glacière du 18e siècle qui servait autrefois à conserver les aliments au frais.
Les personnalités politiques qui ont marqué l'aménagement du jardin
Depuis 1978, une tradition singulière anime ce lieu : chaque Premier ministre plante un arbre dans le parc, marquant ainsi son passage à Matignon. Cette coutume fut initiée par Raymond Barre qui choisit un érable à sucre. Même les chefs de gouvernement au mandat très court, comme Michel Barnier qui ne resta que 3 mois et 8 jours, ont participé à cet usage en plantant leur arbre – un érable rouge dans son cas. Le jardin abrite également des témoins silencieux de son riche passé, notamment deux tombes de chiens datant de la période où l'Hôtel de Matignon servait d'ambassade d'Autriche-Hongrie (1889-1914). L'une d'elles porte l'inscription touchante « Mime,1898.Wachsamundtreu » (Mime, 1898. Attentif et fidèle). Ces détails insolites participent au charme discret de ce lieu où se joue pourtant une partie de la vie politique française, avec notamment la réunion du Conseil des ministres tous les mercredis matin.
Comment participer aux visites exceptionnelles
Le jardin de Matignon représente un joyau vert de près de 3 hectares niché dans le 7ème arrondissement de Paris. Attaché à l'Hôtel Matignon, résidence officielle du Premier ministre français depuis 1922, ce vaste espace constitue le plus grand jardin privé de Paris avec ses 2,5 hectares, surpassant même le jardin de l'Élysée d'un hectare. Conçu initialement dans les années 1720 par Claude Desgots et Charles Alexandre de Calonne, ce lieu chargé d'histoire s'ouvre rarement au public, rendant chaque visite une occasion précieuse de découvrir ce patrimoine habituellement inaccessible.
Le calendrier des ouvertures et modalités d'inscription
Les occasions de visiter le jardin de Matignon sont rares et très attendues. L'ouverture au public se produit principalement lors des Journées européennes du patrimoine en septembre, moment privilégié pour découvrir ce lieu emblématique de la vie politique française. Il faut noter que depuis 2020, la pratique d'ouverture tous les premiers samedis du mois a été suspendue. Pour accéder à ce lieu prestigieux, les visiteurs doivent se présenter au 36 rue de Babylone, entrée officielle du jardin. Les inscriptions pour ces visites exceptionnelles sont généralement annoncées sur le site officiel du Premier ministre ou via les canaux de communication du Ministère de la Culture quelques semaines avant l'événement. Le nombre de places étant limité, une réservation rapide est recommandée dès l'annonce des dates d'ouverture. Des évènements culturels comme des concerts et des expositions y sont aussi organisés ponctuellement, souvent avec un accès gratuit mais nécessitant une inscription préalable.
Les parcours proposés et points d'intérêt incontournables
Lors d'une visite du jardin de Matignon, plusieurs parcours thématiques sont proposés aux visiteurs pour apprécier pleinement la richesse de ce lieu. Le jardin se divise en diverses parties distinctes: la terrasse, le parterre central, les bosquets et l'orangerie, chacune offrant une perspective unique sur cet espace vert historique. Parmi les attractions majeures figure la tradition de plantation d'arbres: depuis 1978, chaque Premier ministre plante un arbre dans le parc, tradition initiée par Raymond Barre avec un érable à sucre. Les amateurs de botanique admireront les arbres remarquables, notamment un magnolia grandiflora vieux de près de 150 ans s'élevant à plus de 20 mètres. Le jardin recèle également des trésors architecturaux et historiques comme une glacière du 18ème siècle, utilisée autrefois pour conserver les aliments au frais. Les visiteurs pourront aussi découvrir deux tombes de chiens datant de l'époque où le lieu servait d'ambassade d'Autriche-Hongrie (1889-1914), dont l'une porte l'inscription 'Mime, 1898. Wachsam und treu' (Mime, 1898. Attentif et fidèle). Les amateurs d'art apprécieront les statues historiques ornant le jardin, comme celle de Méléagre par Pierre Lepautre (1690) et la statue de l'Abondance par Philippe Mouchy (1773), toutes deux ayant une histoire riche avant leur installation à Matignon.
L'influence du jardin sur les politiques environnementales françaises
Le jardin de Matignon, avec ses 2,5 hectares, représente le plus grand jardin privé de Paris, dépassant même le jardin de l'Élysée d'un hectare. Situé dans le 7ème arrondissement, cet espace vert historique est rattaché à l'Hôtel Matignon, résidence officielle du Premier ministre français depuis 1922. Conçu initialement dans les années 1720 par Claude Desgots et Charles Alexandre de Calonne, il a connu diverses transformations au fil des siècles, notamment sa métamorphose en jardin à l'anglaise par Talleyrand entre 1808 et 1811, puis par le paysagiste Achille Duchêne en 1905. Au-delà de sa dimension esthétique et patrimoniale, ce jardin joue un rôle notable dans la vie politique française et s'inscrit dans une démarche environnementale symbolique.
Le jardin comme laboratoire d'expérimentation écologique
Le jardin de Matignon ne se limite pas à sa fonction décorative, il sert aussi d'espace d'expérimentation pour des pratiques écologiques. Sa structure variée, composée d'une terrasse, d'un parterre central, de bosquets et d'une orangerie, offre différents biotopes propices à la biodiversité urbaine. Parmi ses trésors naturels, on trouve des arbres remarquables, dont un magnolia grandiflora âgé de près de 150 ans et s'élevant à plus de 20 mètres de hauteur. Le jardin abrite également des éléments historiques comme une glacière du 18e siècle, autrefois utilisée pour conserver la glace et les aliments au frais, qui témoigne des anciennes méthodes de réfrigération naturelle. La diversité botanique du lieu en fait un véritable conservatoire végétal au cœur de Paris, utilisé comme vitrine pour promouvoir des aménagements respectueux de l'environnement.
Le rôle symbolique des aménagements dans la diplomatie verte
La tradition de plantation d'arbres par chaque Premier ministre, initiée en 1978 par Raymond Barre avec un érable à sucre, illustre la dimension symbolique du jardin dans la politique environnementale française. Cette pratique, qui se poursuit même pour les mandats les plus courts comme celui de Michel Barnier (3 mois et 8 jours), qui planta un érable rouge, traduit un engagement vis-à-vis des questions écologiques à long terme. Le jardin de Matignon sert aussi de cadre prestigieux aux réunions ministérielles, notamment le Conseil des ministres qui s'y réunit tous les mercredis matin, ainsi qu'aux réceptions officielles. Par ailleurs, l'ouverture occasionnelle au public, notamment lors des Journées européennes du patrimoine en septembre, permet de sensibiliser les citoyens aux enjeux de préservation du patrimoine naturel. Les éléments artistiques du jardin, comme la statue de Méléagre par Pierre Lepautre (1690) ou celle de l'Abondance par Philippe Mouchy (1773), ajoutent une dimension culturelle à ce lieu qui combine art, histoire et nature, renforçant son rôle dans la diplomatie environnementale française.